Revue d'Histoire Littéraire de la France
13e Année, Paris, Armand Colin, 1906, p. 346-347.
L’original de cette lettre est conservé dans la collection d’autographes de M. Morrison, à Londres. A qui est-elle adressée ? Je l’ignore. Mais elle peut servir à faire connaître une personne dont l’humeur n’a pas été bien nettement expliquée et qui d’ailleurs, comme on va le voir, était extrêmement portée vers le mysticisme. Faut-il ajouter qu’elle fut l’arrière-grand-mère de Prosper Mérimée et que d’aucuns ont cru trouver quelque analogie entre son style et celui de son descendant ?
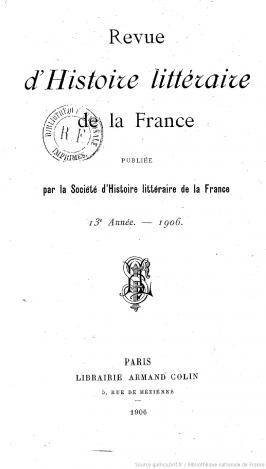 Si je n’écoutais que mon profond respect, je bornerais aux lettres que j’ai eu l’honneur de vous écrire, une correspondance qui m’honore et qui peut vous importuner. Permettez-moi encore cette lettre après laquelle je n’en écrirai plus sans un ordre exprès de votre part.
Si je n’écoutais que mon profond respect, je bornerais aux lettres que j’ai eu l’honneur de vous écrire, une correspondance qui m’honore et qui peut vous importuner. Permettez-moi encore cette lettre après laquelle je n’en écrirai plus sans un ordre exprès de votre part.
Je connais quelqu’un qui est infiniment plus criminel aux yeux de Dieu que vous ne vous dépeignez. Si j’en crois l’aveu héroïque que vous faites, vous aviez éteint les lumières de la foi, et cet aveuglement, quelque criminel qu’il soit, diminue en quelque sorte les plus grands excès. Mon cas est bien différent, et je n’ai pas cette misérable excuse.
Arrachée comme par miracle du milieu du monde avant quatorze ans, je ne portai à Dieu dans son sanctuaire qu’un cœur déjà gâté. J’ai vécu pendant dix ans avec des saints, dans une communauté fervente ; il y a même eu des intervalles où j’ai fait mes efforts pour me donner entièrement à Dieu. Une chaîne d’infidélités me firent devenir infidèle à ma vocation. Je déchirai le cœur de mes supérieurs par une fuite scandaleuse. Vous savez qu’on ne s’éloigne pas de Dieu à demi, c’est la marche de tous les pécheurs qui ont été favorisés de grandes grâces. Mais voici un caractère de noirceur qui m’est particulier. C’est que, malgré mes efforts, ma foi n’a jamais pu être obscurcie ; j’ai connu toute l’énormité de mes fautes en les commettant ; jamais le remords ne s’est émoussé, et pendant vingt ans j’ai vécu en païenne sans oser même paraître aux pieds des autels. Quand je m’y hasardais, il me semblait voir Jésus-Christ même par les yeux corporels, qui me reprochait avec douceur les attentats que je méditais contre lui, qui me conjurait de lui épargner de nouveaux outrages. Je fondais en larmes, et au sortir de là mes chaînes baignées de mes pleurs n’en étaient que plus fortes ; trois fois je les ai brisées, et trois fois mon dernier état est devenu pire que le premier. Le malheureux talent d’une très belle voix me retenait au monde, dont je connaissais le danger, et la nécessité de vivre de ce talent barrait tous mes projets de réformes. Un miracle de miséricorde m’a tirée de cet état déplorable. J’ai tâché de peindre dans Victoire les sentiments que je voudrais avoir, et il est certain que j’ai de moi-même les sentiments que je lui ai prêtés. Mais voici l’incompréhensible. C’est qu’avec ce sentiment de mon indignité mon orgueil se soutient et vit de mille misères que je méprise moi-même. Je donnerais en gros tous les biens, les plaisirs et les honneurs de l’univers pour un acte d’amour de Dieu, et dans le détail je lui refuse mille fois le jour des minuties. Avec le caractère le plus faible, je réunis les passions les plus vives, un cœur de paix qui s’attache à tout ce qu’il touche, et pour vous montrer toutes les contrariétés réunies, c’est que ces Lettres de M. Dumontier, mon Triomphe de la Vérité et plusieurs autres ouvrages où j’ai si bien peint les beautés de la vertu, sont éclos du sein du vice. Jugez combien ils augmentaient mes remords. La bonté de Dieu, m’a pourtant préservée de deux abîmes : la mauvaise communion, des ouvrages licencieux. Vous verrez au jour du jugement que je dois mon retour aux prières de mes saints supérieurs, et vous y verrez aussi que je n’exagère rien. Si l’obéissance à un directeur éclairé n’avait retenu ma plume, j’aurais ôté le masque qui me couvre aux yeux du public ; il ne fallait que reprendre mon nom propre sous lequel j’ai tant scandalisé, mais je scandaliserais encore plus.
Malgré une telle vie, mon âme n’est point touchée des motifs de crainte. J’ai appris dans ma jeunesse que ce ne sont point les fautes passées qui damnent, mais la négligence présente. A ce dernier mal, j’oppose l’offrande des mérites de J.-C. Dieu peut me damner sans injustice, je me condamnerai la première ; mais il me semble, quoi qu’il décide de mon sort, que mon cœur ne le haïra jamais ; dans l’enfer même j’adorerai, je baiserai la main qui me frapperait. Si je perdais de vue cette pensée, le désespoir me rendrait folle, et je suis convaincue que l’abattement ne conduit à rien de bien.
Vous remettez à bien loin l’honneur et le bonheur que vous me faites espérer. Votre Altesse pourrait être ici avec le plus grand incognito. Quel bonheur, quelle bénédiction pour ma cabane, si vous daigniez y accepter une cellule ! J’ai communiqué l’espoir dont vous me flattez au saint ecclésiastique qui me dirige, et qui eût été évêque si la voix du peuple eût influé. Ami de Monseigneur de Genève, il a ses vertus, mais l’écorce en est plus douce ; il allie l’austérité des mœurs avec une aménité qui fait aimer ce qu’ils ont d’amer. En un mot, il rappelle Saint François de Sales qu’il a pris pour son modèle ; et comme ce grand saint, malgré le caractère le plus violent, il est parvenu à ce point de douceur qu’on croirait faiblesse, si on ne savait pas ce qu’elle lui coûte. Je suis bien sûre que Votre Altesse trouverait auprès de lui de grandes consolations.
Que le ciel conserve vos chers enfants, s’ils doivent marcher sur les traces des auteurs de leur naissance ! Qu’il se hâte de les mettre en sûreté dans son sein, s’il prévoit qu’ils dussent se perdre dans le monde. Nouvel Abraham, vous avez plus d’un Isaac à immoler.
Cette lettre finira comme la précédente. Pardon, mille fois pardon ; en écrivant j’oublie que je parle à un Prince ; je ne vois plus que le héros chrétien, et cette vue porte au plus haut degré les sentiments de profond respect avec lequel je suis, etc.
Geneviève Artigas-Menant remarque, au sujet de cette lettre : « Pourquoi le seul document autobiographique incontestable, une lettre, sans doute de 1767 ou 1768, publiée en 1906, est-il rejeté, au moins en partie, par ceux qui de nos jours voudraient dresser d'elle un portrait plus fidèle que ses ennemis du 18e siècle ? [...] Rien de ce que l'on sait maintenant de façon certaine ne vient contredire la lettre autobiographique de 1767-68. On peut même affirmer que cette lettre, dite "de la collection Morrison", sans doute adressée au prince Louis-Eugène de Wurtemberg, est confirmée en tous points à la fois par les médisances malveillantes de Deschamps, les documents d'archives, et la correspondance privée avec son ami, amant, ou mari, Thomas Tyrrell. » Geneviève Artigas-Menant, « Les Lumières de Marie Leprince de Beaumont : Nouvelles données biographiques », Dix-huitième siècle, n°36, (2004), p. 292.
